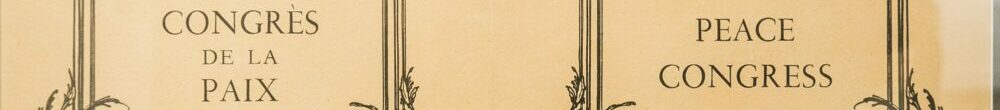Traité de Francfort, 10 mai 1871
entre l’Allemagne et la France

Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire.
Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire. Le traité est conclu par un gouvernement français affaibli, alors que Paris est encore en partie occupée par la Commune.
Le traité consacre la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, désormais annexées à l’Empire allemand. La France est aussi contrainte de verser une indemnité de guerre de cinq milliards de francs-or. En garantie de ce paiement, plusieurs départements français restent occupés par les troupes allemandes jusqu’en 1873. Ces conditions ont été négociées à Versailles, Bruxelles, puis Francfort, notamment par Adolphe Thiers et Jules Favre.
Sur le plan intérieur, le contexte est tendu. L’Assemblée nationale élue en février 1871 est majoritairement monarchiste, tandis que Paris reste hostile à toute capitulation. Le traité est voté à une large majorité, bien que les députés des territoires cédés quittent la séance en signe de protestation.
Pour honorer la dette de guerre, la France émet plusieurs emprunts publics permettant un retrait progressif de l’armée allemande. Une clause du traité permet aussi aux Alsaciens-Lorrains de conserver la nationalité française, à condition de quitter la région avant octobre 1872.
Le traité de Francfort a nourri en France un sentiment de revanche dans les années qui ont suivi. L’Alsace-Lorraine devient un symbole de l’humiliation nationale, mais n’est plus une priorité politique. Comme le soulignera Paul Valéry, le traité laissait à la France le choix entre soumission prolongée et lutte désespérée, illustrant une paix incomplète et instable
Allemagne et France.
Traité de paix entre l’Empire Allemand et la France, signé à Francfort s.M. le 10 mai 1871 : suivi de trois articles additionnels et du protocole de signature.
(Les ratifications ont été échangées à Francfort, le 20 mai 1871)
Le Prince Otto de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l’Empire germanique, le Comte Harry d’Arnim, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne auprès du Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un coté,
de l’autre, M. Jules Favre, Ministre des Affaires Étrangères de la République française, M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l’Assemblée nationale, stipulant au nom de la République française,
S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire de paix du 26 février de l’année en cours, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :
Art. 1 – La distance entre la ville de Belfort et la ligne de frontière telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité préliminaire du 26 février est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhin au Rhône sort du canton de Delle au sud de Montreux-Château jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Felon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, qui laisseront à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
La Commission internationale dont il est question dans l’article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière conformément aux dispositions précédentes.
Art. 2 – Les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés actuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable, faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.
Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.
Art. 3 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand.
Art. 4 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne dans le terme de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce traité :
1° le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés
2° Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés ayant opté pour la nationalité allemande;
3° Le montant des cautionnements des comptables de l’État;
4° Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires suite aux mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.
Art. 5 – Les deux nations bénéficieront d’un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.
Art. 6 – Les Hautes Parties contractantes, étant d’avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1er ci-dessus, se consulteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit à l’Église réformée, soit à la confession d’Augsbourg, établies dans les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l’autorité ecclésiastique française.
Les communautés de l’Église de la confession d’Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.
Art. 7 – Le paiement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours suivant le rétablissement de l’autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année et un demi-milliard au 1er mai mil huit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit cent soixante-quatorze, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. À partir du 2 mars de l’année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an.
Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué.
Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d’Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre valeur comptant.
Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois à l’avance, de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand.
Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février relatives à l’occupation des territoires français après le paiement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le paiement des cinq cents premiers millions.
Art. 8 – Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes.
Relativement à l’alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à l’évacuation des forts de Paris.
En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises en exécution après l’évacuation des forts.
Dès que l’effectif de l’armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées en-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d’entretien des troupes payé par le Gouvernement français.
Art. 9 – Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l’Alsace.
Art. 10 – Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont pas achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu’à l’évacuation des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas quatre-vingt mille hommes.
Jusqu’à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.
Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations.
Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employées dans cette colonie.
Art. 11 – Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.
Sont compris dans cette règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leur agents.
Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie.
Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d’esprit et d’art seront remis en vigueur. Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d’établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.
Art. 12 – Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.
Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.
Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après les échanges des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France.
Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.
Art. 13 – Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.
Ceux qui n’auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.
Art. 14 – Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.
Art. 15 – Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utiles d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l’impossibilité d’arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.
Art. 16 – Les deux Gouvernements, allemand et français, s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.
Art. 17 – Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.
Art. 18 – Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un côté, et de l’autre par l’Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.
Traité de paix de Francfort.
En foi de quoi les parties respectives l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Francfort le 10 mai 1871.
v. Bismarck. Jules Favre.
Arnim. Pouyer-Quertier.
E. de Goulard.
Articles additionnels.
Art. 1 – § 1. D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l’Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.
§ 2. Seront compris dans cette concession:
1° tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que les établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc. ;
2° tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que les barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc. ;
3° tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc. ;
4° les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l’Est en titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.
§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.
§ 4. Le Gouvernement français s’engage à libérer envers l’Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.
§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l’Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués dans le § 2, ainsi que du matériel roulant.
Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées.
§ 6. Le Gouvernement allemand paiera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2 et en contrepartie de l’engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325.000.000) de francs.
On défalquera cette somme de l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Société Royale -Grand- Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement de manière qu’elles ne sont applicables à l’état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est.
Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l’Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s’engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.
Pour le cas où ladite subrogation ne s’effectuerait pas, le Gouvernement français n’accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l’Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n’exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2 – Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l’Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bale, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d’un mois.
Art. 3 – La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l’article 1° du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Felon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Riviere, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelieres, Montreux-Chateaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce. La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d’Alsace restera en France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny.
Fait à Francfort, le 10 mai 1871.
v. Bismarck. Jules Favre
Arnim. Pouyer-Quertier.
E. de Goulard.
Protocole de signature.
Fait à Francfort s. M., le 10 mai 1871.
Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l’ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux. En vertu de quoi ils l’ont muni de leurs signatures. Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu’ils feront partie intégrale du traité de paix.
Le texte du traité est publié in
| 3,4 Mo Martens, N. R. G., t. XIX, n° 124, pp. 688-695Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia