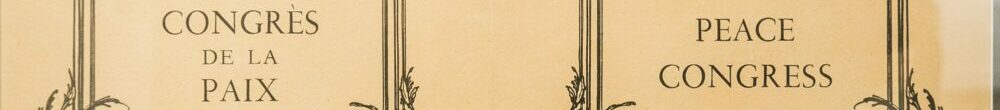#1877, 28 février, Protocole de Constantinople#
1877, 28 février, Protocole de Constantinople
entre la Serbie et la Turquie
publié in | 539 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 12, pp. 171-172
Archives de l’auteur : Romain Le Boeuf
1873, 24 août, Traité de Gandemian
Traité de Gandemian, 24 août 1873
entre la Russie et le khanat de Khiva
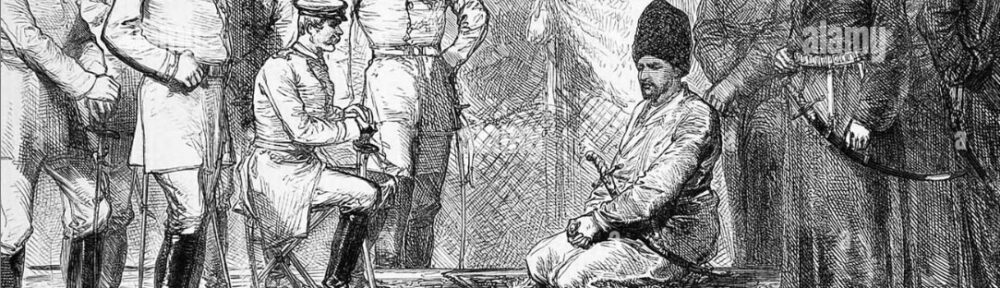
Le traité de Gandemian, signé le 24 août 1873, marque une étape clé dans la conquête russe de l’Asie centrale au 19e siècle. À cette époque, le khanat de Khiva, situé dans la région de l’actuel Ouzbékistan et Turkménistan, était l’un des derniers États indépendants d’Asie centrale. Confronté à l’expansion progressive de l’Empire russe, Khiva tenta de résister à cette pression croissante. Cependant, après une campagne militaire menée par la Russie en 1873, le khanat fut contraint d’accepter la domination russe.
Le traité imposé à Khiva officialisait la suzeraineté russe sur le khanat. En signant ce traité, le khan de Khiva reconnaissait l’autorité russe, notamment en matière de politique extérieure, et acceptait la présence d’une ambassade russe permanente ainsi que la libre circulation des troupes russes sur son territoire. Ce traité transformait ainsi Khiva en protectorat de l’Empire russe, réduisant considérablement son indépendance.
Ce pacte s’inscrivait dans un contexte plus large de rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne, appelée le « Grand Jeu », où les deux puissances cherchaient à étendre leur influence en Asie centrale. La prise de Khiva renforça la position de la Russie dans la région et lui permit de poursuivre l’annexion progressive des autres khanats voisins, consolidant ainsi son empire en Asie centrale. Le traité de Gandemian est donc un moment décisif qui illustre la domination coloniale russe et la fin de l’autonomie des khanats d’Asie centrale à la fin du 19e siècle.
Traité de paix entre la Russie et le Khiva ; signé à Gandemian, le 24 (12) août 1873.
Traduction.
Art. 1 – Séid-Mouhamed-Rahim-Boughadour-Khan se reconnaft fidèle serviteur de l’Empereur de toutes les Russies. Il renonce à toutes relations amicales directes avec les souverains el khans voisins, et à la conclusion de toutes conventions de commerce ou autres avec eux; il s’engage à n’entreprendre contre eux aucune opération de guerre à l’insu ou sans l’assentiment des autorités militaires supérieures russes.
Art. 2 – La frontière entre les territoires russe el khivien sera l’Amou-Daria, à partir de Koutertli, en descendant le cours du fleuve, jusqu’à la sortie de la branche la plus occidentale de l’Amou-Daria, et de ce point, en suivant celte branche jusqu’à son embouchure dans la mer d’Aral; plus loin, la frontière longera le rivage de cette mer jusqu’au cap Ourgou, et de là elle suivra le pied du versant méridional de l’Oust-Ourl jusqu’à ce que l’on appelle l’Ancien-Cours du fleuve Amou.
Art. 3 – Toute la rive droite de l’Amou-Daria et tous les territoires qu’il baigne, et qui jusqu’aujourd’hui ont été considérés comme territoires khiviens, passent de la possession du khan à celle de la Russie avec toutes les populations qui y résident ou qui y campent. Les parcelles de terrain situées sur la rive droite, et qui sont actuellement propriété du khan, ou dont il a octroyé la jouissance à des fonctionnaires du khanat, passent avec le reste en la possession du gouvernement russe, sans que les anciens propriétaires puissent élever aucune prétention. Il est réservé au khan de les dédommager pour leurs pertes par des terrains situés sur la rive gauche.
Art. 4 – Dans le cas où, conformément à la volonté de S. M. l’Empereur, la possession, d’une partie de celle rive droite serait transférée à l’Emir de Boukhara, le khan de Khiva reconnaîtra ce dernier comme légitime possesseur de celle partie de ses anciens domaines et renoncera à toute intention d’y rétablir son autorité.
Art. 5 – Il est exclusivement réservé aux bâtiments à vapeur et autres navires russes appartenant soit au gouvernement, soit aux particuliers, do naviguer librement sur l’Amou-Daria. Les barques khiviennes et boukhariennes ne peuvent jouir de ce droit que moyennant une permission spéciale de l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale.
Art. 6 – Les Russes ont le droit d’établir des ports dans les localités de la rive gauche où ils le jugeront nécessaire et opportun. Le gouvernement du khan répond de la sécurité et de la conservation de ces ports. La confirmation des localités choisies pour leur établissement dépend de l’autorité russe de l’Asie centrale.
Art. 7 – Indépendamment de ces ports, les Russes ont le droit d’avoir des factoreries sur la rive gauche de l’Amou-Daria pour l’entrepôt et l’emmagasinage de leurs marchandises. — Le gouvernement du khan s’engage à délivrer pour l’établissement de ces factoreries, dans les localités qui seront désignées par l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale, des terres inoccupées en quantité suffisante pour la construction des ports, des magasins, des emplacements destinés aux employés des factoreries, et à ceux qui y auront affaire, pour l’organisation des comptoirs des marchands et de fermes agricoles. Ces factoreries, avec tous ceux qui les habitent et les marchandises qu’elles contiennent, sont placées sous la protection immédiate du gouvernement du khan, qui répond de leur sécurité et de leur conservation.
Art. 8 – Toutes les villes el les villages du khanat de Khiva sont désormais ouverts au commerce russe. Les marchands et les caravanes russes peuvent circuler librement dans toute l’étendue du khanat et jouissent de la protection spéciale des autorités locales. Le gouvernement du khan répond de la sécurité des caravanes et des dépôts de marchandises.
Art. 9 – Les marchands russes, faisant le commerce dans le khanat, sont affranchis du paiement du Ziaket et de toute espèce de redevance commerciale, de même que les marchands khiviens sont depuis longtemps exemptés du Ziaket, tant sur la route pour Kazalinsk, qu’à Orenbourg et dans les ports de la mer Caspienne.
Art. 10 – Les marchands russes jouissent du droit de transit gratuit pour les marchandises expédiées à travers les possessions khiviennes, dans tous les pays voisins.
Art. 11 – Les marchands russes ont le droit d’avoir, s’ils le désirent, leurs agents (caravanbachis) à Khiva et dans les autres villes du khanat, pour les relations avec les autorités locales, et le contrôle de la marche régulière des affaires de commerce.
Art. 12 – Les marchands russes ont le droit d’acquérir des propriétés immobilières dans le khanat. Celles ci seront soumises à l’impôt foncier d’après un accord avec l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale.
Art. 13 – Les engagements commerciaux entre les Russes et les Khiviens doivent être strictement et inviolablement remplis de part et d’autre.
Art. 14 – Le gouvernement du khan s’engage à examiner sans délai les plaintes et réclamations des sujets russes contre des Khiviens et, si elles se trouvent fondées, à y donner immédiatement satisfaction. Dans le cas de procès de la part de sujets russes et de Khiviens, les Russes auront la priorité sur les Khiviens pour le remboursement de leurs créances.
Art. 15 – Les plaintes et réclamations des Khiviens contre des sujets russes, même dans le cas où ces derniers se trouvent dans les limites du khanat, sont soumises à l’examen et au jugement de l’autorité russe la plus proche.
Art. 16 – Le gouvernement du khan n’admet dans aucun cas sur son territoire les divers émigrés venant de la Russie et se présentant sans être munis de permis à cet effet de la part des autorités russes, quelle que soit la nationalité à laquelle appartiennent ces émigrés. Si des criminels, sujets russes, cherchent un abri contre les poursuites légales dans les limites du khanat, le gouvernement du khan s’engage à les arrêter et à les livrer à l’autorité russe la plus proche.
Art. 17 – La déclaration de Seïd·Mouhammed-Rahim-Bog- badour-Khan, publiée le 12 du mois de juin dernier, concernant la libération de tous les esclaves dans le khanat et l’abolition à tout jamais de l’esclavage et du trafic des hommes, demeure en pleine vigueur et le gouvernement du khan s’engage à veiller, par tous les moyens en son pouvoir, à la stricte et consciencieuse exécution de cette clause.
Art. 18 – Une indemnité de 2,200,000 roubles est imposée au khanat de Khiva afin de couvrir les dépenses encourues par le trésor russe, pour les frais de la dernière guerre, provoquée par le gouvernement du khan el par le peuple khivien eux-mêmes.
Comme le gouvernement du khan n’est pas en état de payer cette somme à bref délai, vu l’insuffisance de l’argent tant dans le pays que dans les caisses de l’Etat, en considération de cette difficulté, la faculté lui est réservée de payer cette indemnité par termes, en comptant les intérêts à 5% par an, à condition que dans l’espace des deux premières années il soit versé au trésor russe cent mille roubles par an; dans les deux an- nées suivantes, cent vingt-cinq mille roubles pour chaque année; en 1877 et 1878 cent cinquante mille roubles chaque année; puis cent soixante-quinze mille roubles chacune des deux années suivantes; en 1881, c’est à dire dans huit ans, deux cent mille roubles, et enfin la même somme de deux cent mille roubles au moins· par an jusqu’au paiement définitif. Les versements peuvent être effectués tant en billets de crédit russes qu’en monnaie oyant cours dans le khanat, selon le désir du gouvernement du khan.
Le terme du premier versement est fixe au 1er décembre 1873. En compte de ce paiement, la faculté est accordée au gouvernement du khan de prélever l’impôt sur la population de la rive droite, pour l’année courante, dans la mesure existante jusqu’à ce moment; cette perception doit être terminée au 1er décembre, à la suite d’une entente entre les percepteurs du khan et les autorités locales russes.
Les versements suivants doivent être effectués le 1er novembre de chaque année jusqu’à l’entier paiement de d’indemnité avec les intérêts.
Dans 19 ans, c’est-à-dire au 1er novembre 1892. après le paiement de 200 mille roubles pour la dite année, il restera encore au gouvernement du khan à payer 70,054 r et le 1er novembre 1893 il aura à verser les derniers 73,557 r.
Il est réservé au gouvernement du khan la faculté de payer plus que les sommes annuelles ci-dessus désignés, … s’il désire diminuer le nombre des années de paiement et les intérêts à courir pour le restant de sa dette.
Ces conditions ont été stipulées et acceptées réciproquement par le gouverneur général du Turkestan, aide de camp général de Kaufmann Ier d’une part, et de l’autre par le souverain du Khiva, Seïd-Mouhamed-Rahim-Boghadour-Khan, et doivent être strictement exécutées et servir de règle permanente. — Fait à Gandemian (au camp de l’armée russe sous Khiva) le 12août 1873 (le 1er jour du mois de Radjab 1290).
Le texte du traité est publié in
| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XX, n° 97, pp. 97-101Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1872, 9 janvier, Traité d’Asunción
#1872, 9 janvier, Traité d’Asunción#
1872, 9 janvier, Traité d’Asunción
entre le Brésil et le Paraguay
publié in | 408 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. IV, n° 94, pp. 568-572 (en Espagnol)
1871, 10 mai, Traité de Francfort
Traité de Francfort, 10 mai 1871
entre l’Allemagne et la France

Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire.
Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire. Le traité est conclu par un gouvernement français affaibli, alors que Paris est encore en partie occupée par la Commune.
Le traité consacre la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, désormais annexées à l’Empire allemand. La France est aussi contrainte de verser une indemnité de guerre de cinq milliards de francs-or. En garantie de ce paiement, plusieurs départements français restent occupés par les troupes allemandes jusqu’en 1873. Ces conditions ont été négociées à Versailles, Bruxelles, puis Francfort, notamment par Adolphe Thiers et Jules Favre.
Sur le plan intérieur, le contexte est tendu. L’Assemblée nationale élue en février 1871 est majoritairement monarchiste, tandis que Paris reste hostile à toute capitulation. Le traité est voté à une large majorité, bien que les députés des territoires cédés quittent la séance en signe de protestation.
Pour honorer la dette de guerre, la France émet plusieurs emprunts publics permettant un retrait progressif de l’armée allemande. Une clause du traité permet aussi aux Alsaciens-Lorrains de conserver la nationalité française, à condition de quitter la région avant octobre 1872.
Le traité de Francfort a nourri en France un sentiment de revanche dans les années qui ont suivi. L’Alsace-Lorraine devient un symbole de l’humiliation nationale, mais n’est plus une priorité politique. Comme le soulignera Paul Valéry, le traité laissait à la France le choix entre soumission prolongée et lutte désespérée, illustrant une paix incomplète et instable
Allemagne et France.
Traité de paix entre l’Empire Allemand et la France, signé à Francfort s.M. le 10 mai 1871 : suivi de trois articles additionnels et du protocole de signature.
(Les ratifications ont été échangées à Francfort, le 20 mai 1871)
Le Prince Otto de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l’Empire germanique, le Comte Harry d’Arnim, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne auprès du Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un coté,
de l’autre, M. Jules Favre, Ministre des Affaires Étrangères de la République française, M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l’Assemblée nationale, stipulant au nom de la République française,
S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire de paix du 26 février de l’année en cours, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :
Art. 1 – La distance entre la ville de Belfort et la ligne de frontière telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité préliminaire du 26 février est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhin au Rhône sort du canton de Delle au sud de Montreux-Château jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Felon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, qui laisseront à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
La Commission internationale dont il est question dans l’article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière conformément aux dispositions précédentes.
Art. 2 – Les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés actuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable, faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.
Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.
Art. 3 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand.
Art. 4 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne dans le terme de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce traité :
1° le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés
2° Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés ayant opté pour la nationalité allemande;
3° Le montant des cautionnements des comptables de l’État;
4° Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires suite aux mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.
Art. 5 – Les deux nations bénéficieront d’un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.
Art. 6 – Les Hautes Parties contractantes, étant d’avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1er ci-dessus, se consulteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit à l’Église réformée, soit à la confession d’Augsbourg, établies dans les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l’autorité ecclésiastique française.
Les communautés de l’Église de la confession d’Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.
Art. 7 – Le paiement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours suivant le rétablissement de l’autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année et un demi-milliard au 1er mai mil huit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit cent soixante-quatorze, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. À partir du 2 mars de l’année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an.
Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué.
Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d’Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre valeur comptant.
Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois à l’avance, de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand.
Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février relatives à l’occupation des territoires français après le paiement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le paiement des cinq cents premiers millions.
Art. 8 – Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes.
Relativement à l’alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à l’évacuation des forts de Paris.
En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises en exécution après l’évacuation des forts.
Dès que l’effectif de l’armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées en-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d’entretien des troupes payé par le Gouvernement français.
Art. 9 – Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l’Alsace.
Art. 10 – Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont pas achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu’à l’évacuation des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas quatre-vingt mille hommes.
Jusqu’à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.
Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations.
Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employées dans cette colonie.
Art. 11 – Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.
Sont compris dans cette règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leur agents.
Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie.
Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d’esprit et d’art seront remis en vigueur. Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d’établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.
Art. 12 – Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.
Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.
Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après les échanges des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France.
Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.
Art. 13 – Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.
Ceux qui n’auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.
Art. 14 – Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.
Art. 15 – Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utiles d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l’impossibilité d’arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.
Art. 16 – Les deux Gouvernements, allemand et français, s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.
Art. 17 – Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.
Art. 18 – Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un côté, et de l’autre par l’Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.
Traité de paix de Francfort.
En foi de quoi les parties respectives l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Francfort le 10 mai 1871.
v. Bismarck. Jules Favre.
Arnim. Pouyer-Quertier.
E. de Goulard.
Articles additionnels.
Art. 1 – § 1. D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l’Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.
§ 2. Seront compris dans cette concession:
1° tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que les établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc. ;
2° tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que les barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc. ;
3° tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc. ;
4° les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l’Est en titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.
§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.
§ 4. Le Gouvernement français s’engage à libérer envers l’Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.
§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l’Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués dans le § 2, ainsi que du matériel roulant.
Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées.
§ 6. Le Gouvernement allemand paiera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2 et en contrepartie de l’engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325.000.000) de francs.
On défalquera cette somme de l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Société Royale -Grand- Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement de manière qu’elles ne sont applicables à l’état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est.
Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l’Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s’engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.
Pour le cas où ladite subrogation ne s’effectuerait pas, le Gouvernement français n’accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l’Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n’exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2 – Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l’Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bale, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d’un mois.
Art. 3 – La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l’article 1° du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Felon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Riviere, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelieres, Montreux-Chateaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce. La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d’Alsace restera en France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny.
Fait à Francfort, le 10 mai 1871.
v. Bismarck. Jules Favre
Arnim. Pouyer-Quertier.
E. de Goulard.
Protocole de signature.
Fait à Francfort s. M., le 10 mai 1871.
Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l’ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux. En vertu de quoi ils l’ont muni de leurs signatures. Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu’ils feront partie intégrale du traité de paix.
Le texte du traité est publié in
| 3,4 Mo Martens, N. R. G., t. XIX, n° 124, pp. 688-695Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1866, 3 octobre, Traité de Vienne
#1866, 3 octobre, Traité de Vienne#
1866, 3 octobre, Traité de Vienne
entre l’Autriche et l’Italie
publié in | 18,7 Mo Martens, N. R. G., t. XVIII, n° 105, pp. 405-413
1864, 30 octobre, Traité de Vienne
#1864, 30 octobre, Traité de Vienne#
1864, 30 octobre, Traité de Vienne
entre l’Autriche, la Prusse d’une part, et le Danemark d’autre part
publié in | 3,4 Mo Martens, N. R. G., t. XVII, part. 2, n° 87, pp. 474-486
1863, 30 décembre, Traité de Pensaqui
#1863, 30 décembre, Traité de Pensaqui#
1863, 30 décembre, Traité de Pensaqui
entre la Colombie et l’Équateur
publié in | 402 Ko Martens, N. R. G., t. XX, n° 106, pp. 594-595
1860, 26 avril, Traité de Tétouan
Traité de Tétouan, 26 avril 1860
entre l’Espagne et le Maroc

Le traité de Wad-Ras, signé à Tétouan le 26 avril 1860 marque la fin de la guerre hispano-marocaine qui avait éclaté quelques mois plus tôt entre le royaume d’Espagne et l’Empire chérifien. Ce conflit trouve son origine dans des tensions autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, fréquemment attaquées par des tribus marocaines.
Après plusieurs affrontements, l’armée espagnole remporte une victoire décisive à la bataille de Tétouan et occupe la ville. Le traité de paix est signé à Wad-Ras, localité située non loin de Tétouan. Ce texte impose au Maroc des conditions particulièrement sévères : le royaume est contraint de verser une indemnité de guerre considérable, estimée à vingt millions de duros.
En attendant le paiement intégral de cette dette, la ville de Tétouan reste sous occupation espagnole. Le traité accorde également à l’Espagne une extension de ses territoires autour de Ceuta et Melilla, ainsi qu’un droit d’établissement à Santa Cruz de Mar Pequeña, sur la côte atlantique marocaine ; futur point d’ancrage de la présence espagnole à Ifni.
Ce traité constitue un tournant. Il affaiblit durablement le Maroc sur le plan économique, précipitant le recours à l’endettement extérieur, et marque un renforcement significatif de la présence espagnole en Afrique du Nord. Il s’inscrit dans un contexte plus large de pressions européennes sur les États non occidentaux à la fin du XIXe siècle.
Armistice — Espagne et Maroc
Convention d’armistice entre l’Espagne et le Maroc, signée près du campement de Gualdras le 25 mars 1860.
Les bases préliminaires du traité de paix ayant été convenues et signées entre l’Espagne et le Maroc par Léopold O’Donnell, duc de Tetuan, capitaine général en chef de l’armée espagnole en Afrique, et Muley-el-Abbas, calife de l’empire du Maroc et prince de l’Algarbe, à partir de ce jour cessera toute hostilité entre les deux armées, le pont de Buseja devant être la ligne qui divisera les deux armées.
Les soussignés donneront dans ce sens les ordres les plus péremptoires à leurs armées respectives, châtiant sévèrement quiconque y contreviendrait. Muley-el-Abbas s’oblige à empêcher les hostilités des Kabyles, et si par hasard ils en commettaient malgré lui, il autorise l’armée espagnole à les châtier, sans que pour cela il soit entendu que la paix ait été altérée.
Le 25 mars 1860.
Léopold O’Donnell, Muley-el-Abbas.
XCIV.
Traité de paix entre l’Espagne et le Maroc, signé à Tétuan, le 26 avril 1860
Au nom du Dieu tout-puissant, traité de paix et d’amitié entre S. M. dona Isabelle II, reine des Espagnes, et Sidi-Mohammed, roi de Maroc, Fez, Mequinez, etc. — Les parties contractantes pour Sa Majesté Catholique sont ses plénipotentiaires : D. Luis Garcia y Miguel, chevalier, etc. etc. ; lieutenant général des armées nationales, chef de l’état-major général de l’armée d’Afrique, et D. Tomas de Ligues y Bardaji, majordome de semaine de Sa Majesté Catholique, etc. etc. ; ministre résident et directeur de la politique dans la première secrétairerie d’État ; et pour Sa Majesté Marocaine, ses plénipotentiaires le serviteur de l’empereur, etc., l’avocat el Sid-Mohammed-el-Jetib, et le serviteur de l’empereur, etc., chef de la garnison de Tanger, caïd de la cavalerie, el Sid-el-Hadch-Ajmad Chabli, ben-Abd-el-Melck, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des articles suivants :
ART. 1 –
Il y aura paix et bonne amitié perpétuelles entre S. M. la reine des Espagnes et S. M. le roi de Maroc et entre leurs sujets respectifs.
ART. 2 –
Pour faire disparaître les causes qui ont motivé la guerre aujourd’hui heureusement terminée, S. M. le roi de Maroc, animé du désir sincère de consolider la paix, convient d’étendre le territoire appartenant à la juridiction de la place espagnole de Ceuta jusqu’aux lieux les plus convenables pour la sûreté et la Défense complète de sa garnison, ainsi qu’il sera déterminé dans l’article suivant.
ART. 3 –
Afin de mettre en exécution la stipulation de l’article précédent, S. M. le roi de Maroc cède à S. M. la reine des Espagnes, en pleine possession et souveraineté, le territoire compris depuis la mer, en& suivant les hauteurs de Sierra Ballones jusqu’au ravin d’Anghera.
Comme conséquence de ce qui précède, S. M. le roi de Maroc cède à S. M. la reine des Espagnes, pour le posséder en pleine souveraineté, tout le territoire compris depuis la mer, en partant près de la pointe orientale de la première baie de Handaz-Bahma, sur la côte septentrionale de la place de Ceuta, et suivant le ravin ou ruisseau qui y finit, en montant ensuite vers la partie orientale du terrain où est la prolongation du mont du Rénégat, qui suit la même direction sur la côte, se déprime très-brusquement pour finir par un escarpement parsemé de pierres d’ardoises et descend en cotôyant, depuis le passage étroit qui s’y trouve, par le versant des montagnes de Sierra Ballones, où sont situées les redoutes de Isabelle II, Francisco de Asis, Pines, Cisneros et Prince Alfonso, en arabe Uad-Aniat, pour se perdre dans la mer ; le tout formant un arc de cercle qui termine dans la baie du Prince Alfonse, en arabe ad-Aniat, sur la côte sud de la place de Ceuta, ainsi qu’il a été reconnu et déterminé par les commissaires espagnols et marocains, dans la convention passée et signée par eux le 4 avril dernier.
Pour conserver ces limites, il sera établi un camp neutre qui partira des versants opposés du ravin pour aller jusqu’à la cime des montagnes de l’une à l’autre partie de la mer, ainsi qu’il est stipulé dans le même article de la convention mentionnée.
ART. 4 –
Il sera ensuite nommé une commission composée d’ingénieurs espagnols et marocains qui marqueront par des poteaux et bornes les hauteurs indiquées dans l’article 3, en suivant les limites convenues.
Cette opération sera accomplie dans le plus bref délai possible ; mais les autorités espagnoles n’auront pas
besoin d’en attendre la fin pour exercer leur juridiction, au nom de Sa Majesté Catholique, sur ce territoire, lequel, comme tout autre cédé par traité par S. M. le roi de Maroc a Sa Majesté Catholique sera considéré comme soumis à la souveraineté de S. M. la reine d’Espagne depuis le jour de la signature de la présente convention.
ART. 5 –
S. M. le roi de Maroc ratifiera dans le plus bref délai la convention que les plénipotentiaires d’Espagne et ce Maroc ont signée à Tétouan le 24 août 1859. Sa Majesté Marocaine confirme, dès à présent, les cessions territoriales faites par ce pacte international en faveur de l’Espagne, ainsi que les garanties, privilèges et gardes de Maures du roi octroyés au Peñón et Alhucemas, ainsi que l’indique l’article 6 de la convention précitée sur les limites de Melilla.
ART. 6 –
Il sera placé, dans la limite des terrains neutres concédés par S. M. le roi de Maroc aux places espagnoles de Ceuta et Melilla, un caïd ou gouverneur avec des troupes régulières pour éviter et réprimer les attaques des tribus. Les gardes de Maures du roi pour les places espagnoles du Peñon et Alhucemas seront placés au bord de la mer.
ART. 7 –
S. M. le roi de Maroc s’engage à faire respecter par ses propres sujets les territoires qui, conformément aux stipulations du présent traité, restent sous la souveraineté de S. M. la reine d’Espagne. Sa Majesté Catholique pourra néanmoins adopter toutes les mesures qu’elle jugera opportunes pour la sûreté de ces territoires et y faire élever toutes les fortifications et défenses qu’elle croira convenables, sans que les autorités marocaines puissent jamais y mettre obstacle.
ART. 8 –
Sa Majesté Marocaine s’engage à concéder à perpétuité à Sa Majesté Catholique, sur la côte de l’Océan, près Santa Cruz la Petite, le territoire suffisant pour la formation d’un établissement de pêcherie, comme celui que l’Espagne y possédait autrefois.
Pour mettre à exécution ce qui a été convenu dans cet article, les gouvernements de Sa Majesté Catholique et de Sa Majesté Marocaine se mettront préalablement d’accord et nommeront des commissaires de part et d’autre pour désigner le terrain et les limites que cet établissement devra occuper.
Sa Majesté Marocaine s’engage à payer à Sa Majesté Catholique, comme indemnité pour les frais de guerre, la somme de 20 millions de piastres, soit 400 millions de réaux de vellon. Cette somme sera remise en quatre versements à la personne désignée par Sa Majesté Catholique dans le port désigné par S. M. le roi de Maroc, et de la manière suivante : 100 millions de réaux de vellon le 1er juillet, 100 millions le 29 août, 100 millions le 29 octobre et 100 millions le 28 décembre de la présente année.
Si S. M. le roi de Maroc payait la totalité de la somme précitée avant les délais fixes, l’armée espagnole évacuera sur-le-champ la ville de Tetuan et son territoire. Tant que ce paiement total n’aura pas lieu, les troupes espagnoles occuperont la place de Tetuan et le territoire qui comprend l’ancien pachalic de Tetuan.
ART. 10 –
S. M. le roi de Maroc, en suivant l’exemple de ses illustres prédécesseurs, qui accordèrent une protection si efficace et spéciale aux missionnaires espagnols, autorise l’établissement, dans la ville de Fez, d’une maison de missionnaires espagnols, et confirme en leur faveur tous les privilèges et exemptions que les précédents souverains de Maroc leur avaient accordés.
Ces missionnaires espagnols pourront, dans toutes les parties de l’empire marocain où ils se trouvent ou s’établiront, se livrer librement à l’exercice de leur saint ministère, et leurs personnes, maisons et hospices jouiront de toute la sécurité et protection nécessaires. S. M. le roi de Maroc donnera dans ce sens les ordres opportuns à ses autorités et délégués pour qu’ils accomplissent de tous temps les stipulations contenues dans cet article.
ART. 11 –
ll a été convenu expressément que lorsque les troupes espagnoles évacueront Tetuan il pourra être acheté l’espace de terrain nécessaire, près le consulat d’Espagne, pour la construction d’une église dans laquelle les prêtres espagnols pourront exercer le culte catholique et célébrer des messes pour les soldats espagnols morts pendant la guerre.
S. M. le roi de Maroc promet que l’église, l’habitation des prêtres et les cimetières des Espagnols seront respectés, et il donnera les ordres nécessaires à ce sujet.
ART. 12-
Afin d’éviter des événements comme ceux qui ont occasionné la dernière guerre et faciliter autant que possible la bonne intelligence entre les deux gouvernements, il a été convenu que le représentant de S. M. la reine des Espagnes dans les États du Maroc résidera à Tetuan, ou dans la ville que Sa Majesté Catholique jugera la plus convenable pour la protection des intérêts espagnols et le maintien des relations amicales entre les deux États.
ART. 13 –
Il sera conclu, dans le plus bref délai possible, un traité de commerce par lequel tous les avantages déjà accordés ou qui seraient accordés à l’avenir à la nation la plus favorisée seront concédés aux sujets espagnols.
S. M. le roi de Maroc, persuadé de la convenance de cultiver les relations commerciales entre les deux peuples, offre de contribuer pour sa part à faciliter autant que possible lesdites relations, en ayant égard aux nécessités mutuelles et à la convenance des deux parties.
ART. 14 –
Jusqu’à ce que le traité de commerce, dont il vient d’être question, soit conclu, les traités existant entre les deux nations avant la dernière guerre resteront en vigueur en tant qu’il n’y a pas été dérogé par la présente. Dans un bref délai, qui ne dépassera pas un mois après la ratification de ce traité, les commissaires, nommés par les deux gouvernements, se réuniront pour conclure le traité de commerce.
ART. 15 –
S. M. le roi de Maroc concède aux sujets espagnols la permission d’acheter et exporter librement les bois des forêts de ses États, en payant les droits, à moins qu’il ne juge convenable, par une disposition générale, de prohiber l’exportation à toutes les nations, sans que pour cela la concession faite à Sa Majesté Catholique par le traité de 1799 soit considérée comme changée.
ART. 16 –
Les prisonniers faits par les troupes de l’une et de l’autre armée, pendant la guerre qui vient de finir, seront immédiatement mis en liberté et livrés aux autorités respectives des deux États.
Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et l’échange des ratifications aura lieu à Tétouan dans le délai de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les soussignés ont fait ce traité en langue espagnole et arabe en quatre exemplaires : un pour Sa Majesté Catholique, un pour Sa Majesté Marocaine ; un qui restera entre les mains de l’agent diplomatique ou du consul général d’Espagne au Maroc, et le dernier pour le ministre des relations extérieures de ce royaume.
Les plénipotentiaires l’ont signé et cacheté du sceau de leurs armes, à Tétouan, le 26 avril 1860 (4 chival 1266 de l’ère hégire).
Signé : Louis Garcia. Tomas de Ligues y Bardaji.
Muhamimed-el-Jetib.
Ajmed-el-Chabli, fils d’Abd-el-Melek.
XCV.
Convention de Cartel entre la Prusse et la Russie, signée à Berlin, le 8 août 1857
Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, La Convention de Cartel concluée le 20/8 mai 1844 entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies…
*L’échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 4 septembre de la même année.
Le texte du traité est publié in
| 1,5 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 94, pp. 590-595Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Mélissa Alvares (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications
1857, 4 mars, Traité de Paris
Traité de Paris, 4 mars 1857
entre la Grande-Bretagne et la Perse

Le traité de Paris du 4 mars 1857 met fin à la guerre anglo-perse qui opposa , de novembre 1856 à avril 1857, l’Empire britannique à la Perse. Le traité acte le retrait des Perses d’Hérat et ont signés un traité de commerce. De leurs côtés les Britanniques ont accepté de ne pas accueillir les opposant au Shah.
La guerre anglo-perse opposant l’Empire britannique à la Perse pris fin en 1857. Les deux parties avaient pour de prendre le contre de la ville d’Herat qui avait déclaré son indépendance de la Perse.
Par la conclusion du traité de Paris en mars 1857 la Perse renonce à Hérat et signe un traité de commerce avec les Britanniques et s’engage à interdit le trafic d’esclaves.
Par la suite, les troupes britanniques évacuent la Perse pour aller combattre en Inde britannique. Le territoire d’cérat passera sous l contrôle effectif de l’Afghanistan en 1863.
Grande-Bretagne et Perse.
By the Minister Plenipotentiary (Mr. Murray) of that Government (England), and also concerning the affair of Herat, and also an arrangement of the affairs of Afghanistan; every promise and agreement, and arrangement, that he shall make will be agreed to and ratified by our Majesty with the greatest satisfaction; and in the fulfillment of these (arrangements), in which will result contentment to the Ministers of both parties, whatever is necessary to friendship will be observed.
Written in the month of Shawal, 1272.
XXV.
Traité de paix entre la Grande-Bretagne et la Perse, signé à Paris, le 4 mars 1857 *).
Texte anglais.
In the name of God the Almighty, the All-Merciful.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty, whose Standard is the Sun, the Sacred, the August, the Great Monarch, the absolute King of Kings of all the States of Persia, being both equally and sincerely animated by a desire to put a stop to the evils of a war which is contrary to their friendly wishes and dispositions, and to re-establish on a solid basis the relations of amity which had so long existed between the two exalted States, by means of a Peace calculated for their mutual advantage and benefit, have appointed as their Plenipotentiaries, for carrying into effect this desired object, the following, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry Richard Charles; Baron Cowley, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of the French, etc., etc., etc.;
And His Majesty the Shah of Persia, His Excellency the Abode of Greatness, the Favourite of the King, Ferokh Khan, Ameen Oolmoolk, the Great Ambassador of the Mighty State of Persia, the Possessor of the Royal Portrait, and of the Blue Cordon, the Bearer of the Diamondstudded Girdle, etc., etc., etc.;
Who, having exhibited and exchanged their full powers, and found them to be in due form, have agreed upon and concluded the following Articles:
Art. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual Peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the other, as likewise between their respective successors, dominions, and subjects.
Art. 2 – Peace being happily concluded between their said Majesties, it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified.
Art. 3 – The High Contracting Parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated.
Art. 4 – His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who may have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war, from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that account.
Art. 5 – His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate measures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein: such withdrawal to be effected within three months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty.
Art. 6 – His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs of Herat or of the countries of Afghanistan any marks of obedience, such as the coinage, ‘khotbeh’, or tribute.
His Majesty further engages to abstain hereafter from all interference with the internal affairs of Afghanistan.
His Majesty promises to recognize the independence of Herat, and of the whole of Affghanistan, and never to attempt to interfere with the independence of those States.
In case of differences arising between the Government of Persia and the countries of Herat and Affghanistan, the Persian Government engages to refer them for adjustment to the friendly offices of the British Government, and not to take up arms unless those friendly offices fail of effect.
The British Government, on their part, engage at all times to exert their influence with the States of Affghanistan, to prevent any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to the Persian Government ; and the British Government, in the event of difficulties arising, will use their best endeavors to compose such differences in a manner just and honorable to Persia.
Art. 7 – In case of any violation of the Persian frontier by any of the States referred to above, the Persian Government shall have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military operations for the repression and punishment of the aggressors; but it is distinetly understood and agreed to, that any military force of the Shah which may cross the frontier, for the above- mentioned purpose, shall retire within its own territory as soon as its object is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned right is not to be made a pretext for the permanent occupation by Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any town or portion of the said States.
Art. 8 – The Persian Government engages to set at liberty without ransom, immediately after the exchange of the ratifications of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the Persian troops in Affghanistan, and all Affghans who may be detained either as hostages or as captives on political grounds in any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set free; provided that the Affghans, on their part, set at liberty, without ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power of the Affghans.
Commissioners on the part of the two Contracting Powers shall, if necessary, be named to carry out the provisions of this Article.
Art. 9 – The High Contracting Parties engage that, in the establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents shall be placed in the dominions of the other on the footing of the most favored nation. The treatment of their respective subjects and their trade shall also, in every respect, be placed on the same footing as the treatment of the subjects and commerce of the most favored nation.
Art. 10 – Immediately after the ratifications of this Treaty have been exchanged, the British Mission shall return to Tehran, when the Persian Government agrees to receive it with the apologies and ceremonies specified in the separate Note signed this day by the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties.
Art. 11 – The Persian Government engages, within three months after the return of the British Mission to Tehran, to appoint a Commissioner, who, in conjunction with a Commissioner to be appointed by the British Government, shall examine into and decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the Government of Persia, and shall pay such of those claims as may ne pronounced just, either in one sum or by instalments, within a period not exceeding one year from the date of the award Commissioners. And the same Commissioners shall examine into and decide upon the claims on the Persian Government of all Persian subjects, or the subjects of other Powers, who, up to the period of the departure of the British Mission from Tehran, were under British protection, which they have not since renounced.
Art. 12 – Saving the provisions in the latter part of the preceding Article, the British Government will renounce the right of protecting hereafter any Persian subject not actually in the employment of the British Mission, or of British Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, provided that no such right is accorded to, or exercised by, any other foreign Powers; but in this, as in all other respects, the British Government requires, and the Persian Government engages, that the same privileges and immunities shall in Persia be conferred upon, and shall be enjoyed by, the British Government, its servants and its subjects, and that the same respect and consideration shall be shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred upon and enjoyed by, and shown to, the most favoured foreign Government, its servants and its subjects.
Art. 13 – The High Contracting Parties hereby renew the Agreement entered into by them in the month of August 1851 (Shawal 1267), for the suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf, and engage further that the said Agreement shall continue in force after the date at which it expires, that is, after the month of August 1862, for the further space of ten years, and for so long afterwards as neither of the High Contracting Parties shall, by a formal declaration, annul it; such declaration not to take effect until one year after it is made.
Art. 14 – Immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, the British troops will desist from all acts of hostility against Persia; and the British Government engages, further, that, as soon as the stipulations in regard to the evacuation, by the Persian troops, of Herat and the Afghan territories, as well as in regard to the reception of the British Mission at Tehran, shall have been carried into full effect, the British troops shall, without delay, be withdrawn from all ports, places, and islands belonging to Persia; but the British Government engages that, during this interval, nothing shall be designedly done by the Commander of the British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their earnest desire to confirm; and, further, the British Government engages that, as far as possible, the subjects of Persia shall be secured against inconvenience from the presence of the British troops, and that all supplies which may be required for the use of those troops, and which the Persian Government engages to direct its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the fair market price, by the British Commissariat, immediately on delivery.
Art. 15 – The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Baghdad in the space of three months, or sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.
Done at Paris, in quadruplicate, this fourth day of the month of March, in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty-seven.
(Signed) Cowley.
Ferokh (in Persian).
Separate Note referred to in Article X of the foregoing Treaty.
The Undersigned, Her Britannic Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Emperor of the French, and His Persian Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His said Imperial Majesty, being duly authorized by their respective Governments, hereby agree that the following ceremonial shall take place for the re-establishment of diplomatic and friendly relations between the Courts of Great Britain and Persia. This agreement to have the same force and value as if inserted in the Treaty of Peace concluded this day between the Undersigned:
The Sadr Azim shall write, in the Shah’s name, a letter to Mr. Murray, expressing his regret at having uttered and given currency to the offensive imputations upon the honour of Her Majesty’s Minister, requesting to withdraw his own letter of the 19th of November, and the two letters of the Minister for Foreign Affairs of the 26th of November, one of which contains a rescript from the Shah, respecting the imputation upon Mr. Murray, and declaring, in the same letter, that no such further rescript from the Shah as that enclosed herewith in copy was communicated, directly or indirectly, to any of the foreign Missions at Tehran.
A copy of this letter shall be communicated, officially, by the Sadr Azim to each of the foreign Missions at Tehran, and the substance of it shall be made public in that capital.
The original letter shall be conveyed to Mr. Murray, at Baghdad, by the hands of some high Persian officer, and shall be accompanied by an invitation to Mr. Murray, in the Shah’s name, to return with the Mission to Tehran, on His Majesty’s assurance that he will be received, with all the honours and consideration due to the Representative of the British Government; another person of suitable rank being sent to conduct him, as Mehmandar, on his journey though Persia.
Mr. Murray, on approaching the capital, shall be received by persons of high rank deputed to escort him to his residence in the town. Immediately on his arrival there, the Sadr Azim shall go in state to the British Mission, and renew friendly relations with Mr. Murray, leaving the Secretary of State for Foreign Affairs to accompany him to the Royale Palace, the Sadr Azim receiving Mr. Murrey, and conducting him to the presence of the Shah.
The Sadr Azim shall visit the Mission at noon on the following day, which visit Mr. Murray will return, at latest, on the following day, before noon.
Done at Paris, this fourth day of the month of March, in the year one thousand hundred and fifty-seven.
(Signed) Cowley
Ferokh (in Persian)
Annex to the preceding Note
The Shah to the Sadr Azim
Décembre 1855
Last night we read the paper written by the English Minister Plenipotentiary, and were much surprised at the rude, unmeaning, disgusting, and insolent tone and purport. The letter which he before wrote was also impertinent. We have Aldo heard that, in his own house he is constantly speaking disrespectfully of us and of you, but he never believed ; now, however, he has introduced it in an official letter.
Le texte du traité est publié in
| 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 25, pp. 114-120Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipédia
1856, 30 mars, Traité de Paris
#1856, 30 mars, Traité de Paris#
1856, 30 mars, Traité de Paris
entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part
publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781